Texte co-écit par Janine BELLANTE, Bernard LENSEL et Eric RAIMONDEAU, Urbanistes des Territoires
Avec un renforcement très net de l’urbanisation dans nos pays d’Europe et notamment en France, un certain nombre de questions peuvent se poser :
– jusqu’où urbaniser et comment fabriquer une ville avec ses nécessaires aménités ?
Avec quelle densité, ou mieux, quelle intensité, assurer une qualité d’accueil et une appropriation du territoire par les habitants ?
– quel doit être la place du rural alors que des métropoles et des intercommunalités avec des villes centres toujours plus grosses s’accaparent le territoire local et phagocytent les communes plus petites ?
-Dans ces conditions, le rural doit-il être sacrifié, voire ignoré ?
-Le périurbain est-il voué nécessairement à la sous-qualité par une sorte de délaissement des structures intercommunales, qui parfois feignent de les considérer ? Le tout rural était à la fois utopique et idéologiquement assez lourd, mais le tout urbain a-t-il de meilleures références ?
Reprenons ces différentes questions et tentons des pistes de réponses.
Du tout rural au tout urbain
Un espace de liberté et d’activité existe, tant que le cadre n’est pas imposé ; le tout rural a servi de lieu de servage, quand il était imposé et que les populations étaient assignées à résidence ; les libertés communales (avec les villes italiennes, alémaniques et flamandes (1) dès les XIème et XII siècle) créaient alors un espace plus propice au développement des activités et à la création.
D’une minorité de population urbaine au Moyen Âge, nous sommes arrivés au cours des XIXème et XXème siècles, avec l’exode rural et la montée de l’industrialisation, à une majorité qui tend actuellement vers 80% de la population dans des pays comparables au nôtre.
Le XXIème siècle est au carrefour de deux évolutions possibles : la poursuite de l’augmentation des urbains jusqu’au chiffre de 100% ou une stabilisation au rapport 80/ 20. La première option rendrait obligatoire ce caractère urbain pour toute personne et en permettrait un contrôle optimum ; la liberté recherchée par les pionniers de l’urbain du Moyen Âge disparaîtrait alors paradoxalement et le fait de tenter de se maintenir dans un environnement non urbain serait jugé suspect ; ce genre de suspicion commence d’ailleurs à poindre (2).
La privation de liberté réapparaîtrait alors avec des phénomènes d’enfermement dans des quartiers dédiés, voire des ghettos, sans grande possibilité d’en sortir et de pratiquer une vraie citoyenneté à l’échelle de toute la ville.
Jouer la complémentarité
La deuxième option est celle de la recherche d’une complémentarité et d’un équilibre. Les conditions de cette recherche sont le maintien de services en milieu rural, un réel maillage du territoire, ce que notre collègue Jean Marly appelle « l’intensité rurale », par opposition à l’intensité urbaine sur laquelle nous allons revenir au sujet du périurbain. (3) Sous l’égide de la DATAR (4), différents scénarios de développement et d’aménagement des territoires en France ont été analysés et commentés en 2013, notamment au CAUE de l’Ain. Le scénario présenté par la DATAR pour 2040 qui s’intitule « Système entreprenant » paraît intéressant à regarder de plus près : il peut concerner les territoires non denses qui veulent affirmer une vie propre, sur les plans culturel et économique, notamment ; il s’appuie sur un jeu relationnel et sur les technologies de télécommunication, pour développer de nouvelles activités et des initiatives créatrices de solutions et d’emplois.
Une possibilité pour les espaces peu denses d’inverser un risque de simple dépendance apparaît donc jouable en apportant des réponses qui échappent à la saturation des déplacements, ainsi qu’à un coût trop important des infrastructures et des services concentrés.
Une stratégie assez fine doit être mise en place et une impulsion momentanée est sans doute souhaitable, tant au niveau du conseil que de l’octroi de quelques moyens : une aide sur le plan fiscal est utilisée avec succès dans certains pays, notamment.
Les exemples de l’implantation d’un musée de renommée internationale à un carrefour de vallées dans une petite ville (le musée Gianadda à Martigny, dans le Valais, en Suisse), de l’aide à la reconversion de toute une vallée industrielle grâce aux nouvelles techniques de communication (la vallée de l’Olt, dans le Sud de la Roumanie), sans parler du regroupement de technologies de pointe, toujours dans une vallée (le Grésivaudan, à proximité de Grenoble, en France). Plus que de tissu à proprement rural, nous pourrons alors parler de « densité adaptée », par opposition à la densité recommandée officiellement sans tout le discernement qui s’imposerait.
Analyse les catégories de périurbain
La France a gagné 1,4 Million d’habitants entre 2006 et 2010, surtout dans les secteurs périurbains.
Partant de l’idée qu’il faut composer avec le périurbain et chercher à le réguler, la DIACT a commandé en 2007 un travail de prospective sur le périurbain.
Cinq scénarios ont été identifiés :
– le périurbain digéré par l’urbain,
– le périurbain dissout dans le confort spatial,
– le périurbain transformé en conservatoire néo-rural,
– le périurbain saisi par l’inter-territorialité,
– le périurbain réquisitionné par les villes-régions,
Ces scénarios extrapolent des tendances à l’œuvre qui annoncent la « diffraction » déjà tangible des futurs périurbains :
– croissance, renouvellement, densification, développement économique, connexion aux transports en commun dans certaines communes de première couronne (scénario 1) ;
– préservation du cadre de vie, malthusianisme foncier, comportement de club, logique de patrimonialisation et de sanctuarisation dans d’autres (scénario 3) ;
– attractivité résidentielle et croissance non contrôlée, réponse aux désirs des ménages, poursuite du desserrement urbain dans les communes lointaines (scénario 2).
Nous aborderons 3 types de périurbain, les espaces périphériques des grandes villes, les premières couronnes des grandes agglomérations qui sont souvent constituées de petites communes que l’on dit périurbaines et le « no manns land » des périphéries de nos petites ou moyennes villes.
Le périurbain des grandes agglomérations
La croissance démographique est essentiellement portée par les petites communes périurbaines. Elles sont plus dynamiques que les grandes villes. Si les communes de moins de 5000 habitants n’abritent que 40 % de la population, elles représentent 70 % de la croissance démographique. «Quelle que soit la taille de la commune, être situé hors de l’espace urbain ou dans une petite agglomération est plus favorable que d’appartenir à une agglomération moyenne», observe l’Insee
Dans ce cas le périurbain a accédé à la maturation d’un concept spatiale grâce au Scot des intercommunalités. Dans le sud de la France notamment ce périurbain est constitué de petites communes qui étaient, dans un passé pas si lointain, des communes rurales. Elles attirent de plus en plus de populations et sont soumises à de grandes pressions foncières car leur territoire urbanisable est souvent grandement limité par les zones à risques, les zones protégées et la volonté de conserver leur réserve agricole et naturelle. Elles sont maintenant reliées avec la ville centre et souvent reliées entre elles. Les SCOT les confortent le plus souvent pour qu’elles tiennent leur rôle dans le maillage de poly-centralisation qui s’est formé et qui doit être accompagné.
La multiplication des centralités secondaires favorise une autonomisation relative des territoires périurbains et contribuent à la formation de bassins de vie périphériques. Elles constituent les poumons des villes centres mais sont souvent le lieu de résidence des plus favorisés. Aussi l’enjeu de mixité sociale est-il une des préoccupations des PLH pour ces territoires. Mais la localisation des zones d’emploi dans ce péri urbain est aussi une préoccupation première car leurs habitants ne doivent pas participer au chassé-croisé des déplacements centre périphérie. Ce concept est encore à optimiser dans nos SCOT.
Le périurbain des petites et moyennes communes
Il dépend essentiellement de la volonté politique locale et résulte d’une vision stratégique de la commune. En ce promenant dans ces espaces le professionnel de l’urbain devine rapidement si le PLU est porteur de volontés ou s’il résulte d’un laisser faire.
Ainsi le plus souvent le périurbain est-il constitué de lotissements juxtaposés ou de petites zones commerciales ou artisanales non pensées.
Quelques exceptions existent lorsque les élus locaux ont donné un peu de leur temps, de le financement pour la réalisation d’un véritable projet communale traduit dans un PLU « Grenellisé » et « Alurisé ».
Mais combien de petites communes françaises investissent pour la réalisation de leur PLU, elles préfèrent et de loin investir dans le goudron et les petites fleurs, bien plus visibles par l’habitant. Le court terme estompe une réflexion pertinente sur le moyen-long terme.
La sauvegarde du rural
«Les communes rurales et les petites villes très éloignées des pôles urbains connaissent quant à elles une croissance démographique beaucoup plus faible», observe l’Insee Pour sauvegarder le rural encore faudrait-il avoir l’envie de sauver notre agriculture comme nous sauvegardons nos territoires naturels.
Les agriculteurs français ne maitrisent pas la prospective commerciale et encore moins la prospective spatiale, comme l’actualité nous le fait cruellement sentir.
De leur avenir dépendent les espaces ruraux de la France. Alors que voulons-nous champs cultivés ou champs délaissés, agriculture de proximité et agriculture des circuits courts ou agriculture intensive dépendante des transports.
De notre choix dépendra l’avenir des territoires ruraux en France.
Passer nécessairement de la densité à l’intensité
Faire la ville très voire trop vite, c’est risquer de générer de l’agglutinement plus que de l’agglomération au sens plus qualitatif.
L’actuel périurbain a été en (grande) partie générée par un processus d’étalement urbain peu contrôlé, reflet de l’esprit sociétal des Trente glorieuses, et planifié parfois a posteriori. La qualité urbaine y est presque inexistante, avec tout au plus quelques gestes architecturaux isolés, en rupture avec le tissu environnant.
Une restructuration de ce type de tissu est alors une solution qui s’impose, de façon à relier ces quartiers souvent périphériques avec la ville et sa centralité initiale : le tandem de la mobilité et de l’affirmation de polarités complémentaires peut alors apporter des réponses pertinentes pour transformer cette non-ville en ville, ou du moins en partie de la ville.
Une ville dense n’est pas forcément intense. De même une ville dense n’est pas forcément créatrice de centralité. Là où une densification purement quantitative risque d’échouer par sa brutalité et son inadéquation au contexte de périphérie, une démarche d’intensification urbaine, qui amènera les services et loisirs dont la population a besoin pour s’approprier l’espace urbain, doit passer nécessairement par une approche qualitative (5).
Il faut une étude fine sur la complémentarité des modes de déplacement entre eux, transports structurants (le tramway et le métro notamment, le métrobus et le métrocâble éventuellement) et modes actifs (piéton, vélo, trottinette, vélopousse, …) ; elle sera complétée par une régulation de l’habitat en vue de l’obtention d’une mixité sociale équilibrée (20 à 35% de logement social paraît être une fourchette qui fait ses preuves) et par une mixité fonctionnelle structurante (commerces, services et cafés-restaurants, à la localisation étudiée).
Des quartiers comme Ijburg à Amsterdam, Hafen-City à Hamburg, Hammarby-Sjöstad à Stockholm, Les Deux Rives à Strasbourg, l’Île de Nantes dans la ville du même nom, offrent d’assez bons exemples de ce que peut donner un traitement de polarité périphérique dynamique, tel que nous l’évoquons ci-dessus.
Un beau défi pour tous les professionnels
Les deux démarches de l’affirmation d’activités en tissu non dense et de la restructuration du tissu périurbain ont un point manifeste en commun, au delà de leurs différences manifestes : elles nécessitent des professionnels de haut niveau, qui agissent avec doigté, en sachant ne pas se laisser uniquement conduire par une normalisation abusive. Laisser davantage de place aux initiatives et au suivi locaux est efficace, quitte à assurer un lien transversal entre les différents terrains d’intervention.
Créer un lien de complémentarité positive avec les décideurs locaux en se positionnant clairement en appui de la maîtrise d’ouvrage est un passage nécessaire.
En dépit des groupes de pression du court terme (financiers et politiciens, notamment), les aménageurs et les urbanistes devront en tout état de cause relever ces défis pour les années à venir et s’inscrire pour cela dans de véritables stratégies territoriales.
(1) Avec des villes aussi différentes que Bologne, Vérone, Lucques, Sienne en Italie ; les villes crées par la dynastie des Zähringen, les deux Freiburg, Bern, Murten, … dans l’espace alémanique ; Arras, Bruges, Gand, Lille, Saint Omer, Ypres, pour les villes des 17 Provinces des Pays-Bas.
(2) L’épisode des jeunes de Tarnac, au-delà de son aspect judiciaire que nous n’avons pas à commenter, se dessine avec un a priori négatif lié au fait que des personnes aient délibérément choisi de « quitter la ville ».
(3) Revue Urbia n°9 sur les Intensités urbaines, et notamment l’article de Jean Marly, intitulé « Pendant de l’intensité urbaine : une intensité rurale à planifier », Lausanne, juillet 2009.
(4) Créée en 1963, la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) est un service du Premier ministre, dirigé par un préfet ; dans une optique de développement durable des territoires, l’action de la DATAR est guidée par un double objectif d’attractivité et de cohésion porté en partenariat avec l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire.
(5) Revue Urbia n°11 sur Centralités, urbanisme durable de projet, notamment les articles d’Antonio da Cunha, Sonia Lavadinho, Bernard Lensel, Yves Chalas, Lausanne, décembre 2011. (14 317 signes)


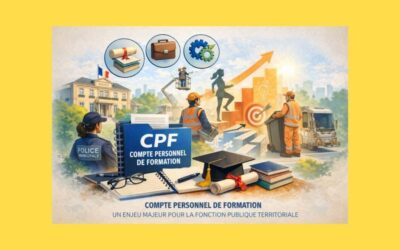
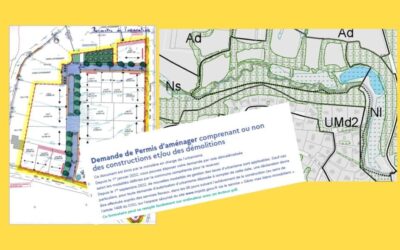

0 commentaires